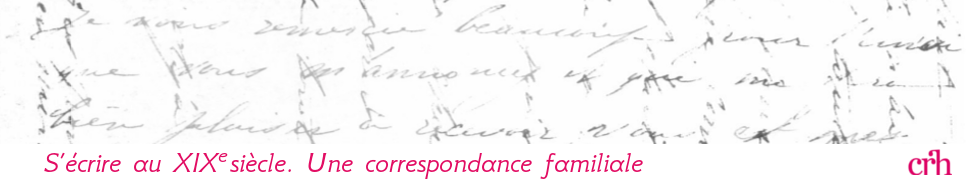1851 |
1851-04
Auguste DumérilLundi 9 juin 1851
Lettre d’Auguste Duméril (Londres) à son épouse Eugénie Duméril (Paris)
d’André Auguste Duméril.
Londres 9 Juin 1851.
Quoiqu’il n’y ait que 4 fois 24 heures que je t’ai quittée, ma petite bien aimée, j’ai mené, depuis ce moment, une vie si remplie, qu’il me semble que notre séparation est de bien plus longue date ; mais au milieu de toutes ces impressions nouvelles et agréables, que j’éprouve, depuis que je suis ici, ton souvenir vient remplir les moments où je me détourne de ce que je vois, et où je me reporte auprès de toi et de notre bonne petite Adèle1. J’espère que tu es aussi contente de ta santé que je le suis de la mienne, qui n’a reçu aucune atteinte de ma secousse de mal de mer. Je désire vivement, mon amie, que tu le te mettes bien dans l’esprit, et qu’aucune préoccupation, par conséquent, ne vienne troubler le plaisir que tu prends à penser à la satisfaction que j’éprouve de voir un pays si différent du nôtre, sous bien des rapports. Je suis en parfaite disposition, ainsi qu’Henri2, et nous n’éprouvons pas de fatigue : nos nuits, quoique n’étant que de 7 heures, à peu près, jusqu’ici, nous reposent très bien. Te raconter en détail toute la journée de samedi, et celle d’hier, serait un peu long : voici cependant, en abrégé, la manière dont notre temps s’est passé. Samedi, après t’avoir écrit, nous avons été voir M. Ashburner, le médecin chez lequel H. logeait, quand il habitait Londres, et il m’a remis des lettres de recommandation, pour visiter les hôpitaux. Avec l’une d’elles, je suis allé voir l’un des chirurgiens de St Barthélemy, et comme les visites se font à une heure, j’ai vu un des chirurgiens faire une très grave opération, devant les élèves. J’ai été bien aise de voir comment les choses se passent. J’ai vu là un célèbre chirurgien, M. Lawrence, auquel je me suis fait présenter. Il m’a fait un parfait accueil, et nous a invités à dîner pour le lendemain, dimanche, à sa campagne. J’ai fait, ce jour-là, une courte visite à M. Gray, au British muséum, dont je n’ai encore vu que de magnifiques salles, remplies de précieuses sculptures antiques. Nous avons fait aussi, ce jour-là, une visite à M. Mitchell, le secrétaire de la société zoologique, et sa femme, qui y était seule, nous a engagés à venir dîner, pour le soir-même. Nous y avons, en effet, été, et j’ai vu ainsi un intérieur anglais assez modeste, en définitive, pour Londres, mais luxueux, si nous le comparons à ce qui se passe en France. Nous avons eu un dîner anglais, et dans tout cela, il y a des détails intéressants, que je réserve pour mon retour. Ils avaient une loge pour le théâtre de la Reine, et nous y sommes allés avec eux. L’impression que j’ai éprouvée en entrant dans cette immense salle, qui est peut-être une fois et demie aussi grande que l’Opéra, admirablement éclairée, et ornée partout de tentures en soie jaune, remplie de femmes, en toilette de bal, est peut-être la plus vive impression que j’aie éprouvée, depuis que je suis à Londres, parce qu’elle était tout à fait inattendue : Dom Pasquale3 avec Lablache, Mme Sontag4, et le ballet du Diable à 45, avec la danseuse Carlotta Grisi, composait, comme tu le vois, un magnifique spectacle, et où j’ai vu la reine6, et une partie de la plus haute société de Londres : le prince Albert était au fond de la loge, et je n’ai pas pu le voir. On n’est sorti qu’après minuit, et nous avons aperçu, en rentrant, une chose commune ici, à ce qu’il paraît : les lueurs d’un incendie. Nous avions visité, dans la journée, en grand détail, la cathédrale de St Paul. A plus tard les détails. Le dimanche matin, nous avons été déjeuner chez M. Mitchell (viande froide, café et thé, usage général), puis nous sommes partis avec lui, pour le jardin Zoologique, où nous avons passé 3 heures ½, à visiter, dans le plus grand détail, ce magnifique établissement, qui est bien changé, depuis que papa ne l’a vu7, car M. Mitchell a fait faire beaucoup de constructions nouvelles : c’est la plus précieuse collection d’animaux vivants qu’on puisse voir. Nous sommes rentrés à l’hôtel, pour nous habiller, et de là, nous avons été par le chemin de fer, à Richmond, admirable parc, à 4 lieues environ de Londres, d’où la vue s’étend sur la plus riante campagne, que parcourt la Tamise. Nous avons mangé, à un célèbre hôtel qu’il y a là, un morceau de pain et de fromage avec de < > (bière) pour la modique somme de 4 F 7 sols, mais aussi, avons-nous vu le célèbre Star and Garter Hôtel. De <là un> fly (mouche), petite voiture, nous a conduits à <Eal...> Park où est la propriété, vraiment princière de M. Lawrence, qui, par l’étendue de sa clientèle, a une fortune considérable. De vastes et très belles serres contiennent les plantes les plus précieuses : des Orchidées, entre autres, et des Bruyères, que papa aurait eu bien du plaisir à voir, et que Mme Lawrence dirige elle-même : aussi, remporte-t-elle tous les prix d’horticulture. Habitation seigneuriale, grand dîner d’apparat, etc. etc. J’ai fait bien des observations intéressantes : je te reparlerai de tout cela. Le chemin de fer nous a ramenés dans Londres, à minuit passé. Le temps a été magnifique et très chaud. Ce matin, nous venons de déjeuner : il est près de 10 heures. Nous allons aller dans la Cité, voir la Tour, les Docks, monter la Tamise, sur un des bateaux à vapeur omnibus, jusqu’à Hyde Parc, où nous ferons notre première visite à l’exposition8. Ce mouvement de Londres, ces queues perpétuelles de voitures et d’omnibus, dans certaines rues, sont quelque chose d’inimaginable, pour qui ne l’a pas vu. Les lettres arrivent, et il n’y en a pas de toi. Tu n’as sans doute pas eu le temps de m’écrire hier, ou bien, peut-être, en recevrai-je une, par le courrier de 4 heures.
Adieu, chère et bonne petite Eugénie : trouve ici l’expression de cette tendresse, que tu sais si bien toi-même m’imprimer, par ton regard et tes paroles ; embrasse bien Adèle, et distribue nos amitiés à chacun, sans oublier Félicie9.
A toi de cœur et d’âme
A aug. Duméril.
Il pleut un peu, mais le temps va, je crois, se remettre.
Je trouve, chez M. Pré, ton affectueuse lettre, chère mignonne, et t’en remercie du fond du cœur. Combien je suis heureux en y lisant l’expression de ton affection pour moi. Je n’ose pas te demander des lettres, parce que ton temps est très pris. Quand tu pourras m’écrire, j’en serai très reconnaissant. Adresse à Trafalgar hôtel : c’est le plus simple. Je vois que, relativement au mariage, les choses paraissent prendre meilleure tournure que je ne le craignais, mais l’époque sera bien gênante pour Trouville.
Je suis bien content que tu aies eu le plaisir du spectacle ; c’était précisément en même temps que toi. Je sais bon gré à Demarquay de cette attention. Merci des bons détails sur chacun, et sur Adèle. J’espère que Félicie va mieux et que maman10 ne se sent plus de faiblesses dans les jambes. Je m’en vais me donner le plaisir de relire ta bonne lettre ; mille et mille nouveaux et tendres baisers.
Tâche, en effet, de ne pas causer longtemps, le soir, avec Félicie, ou je la gronderai bien fort à mon retour. Je te plains bien de tes mauvais rêves de la nuit de jeudi.
Notes
Notice bibliographique
D’après le livre de copies : Lettres de Monsieur Auguste Duméril, 2ème volume, « Voyage à Londres, juin 1851 », p. 558-564
Pour citer ce document
Index
Compléments historiographiques
Cécile Dauphin
Centre de recherches historiques
EHESS
54 boulevard Raspail
F-75006 Paris